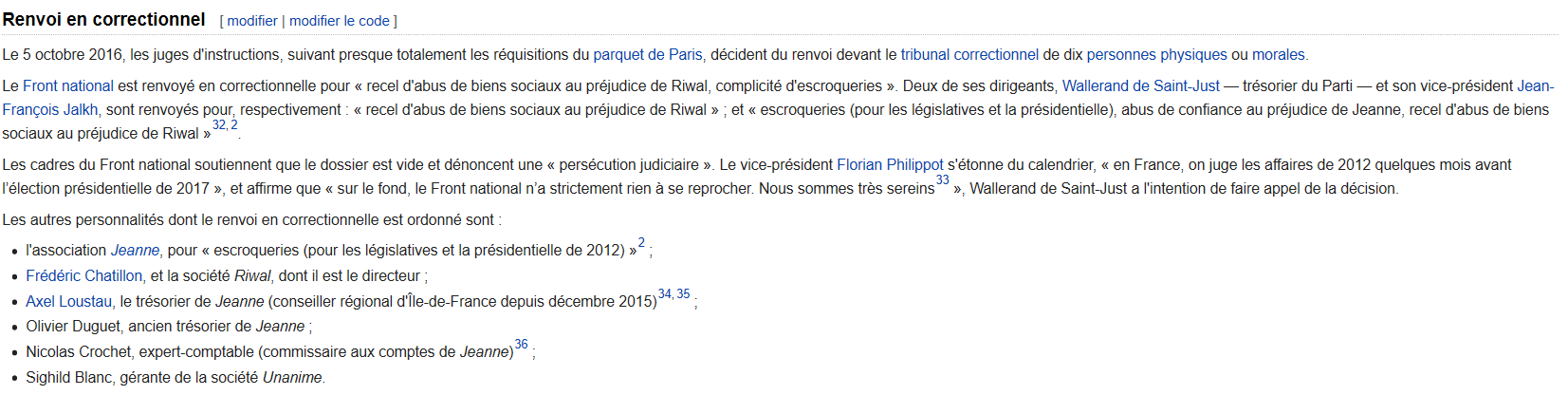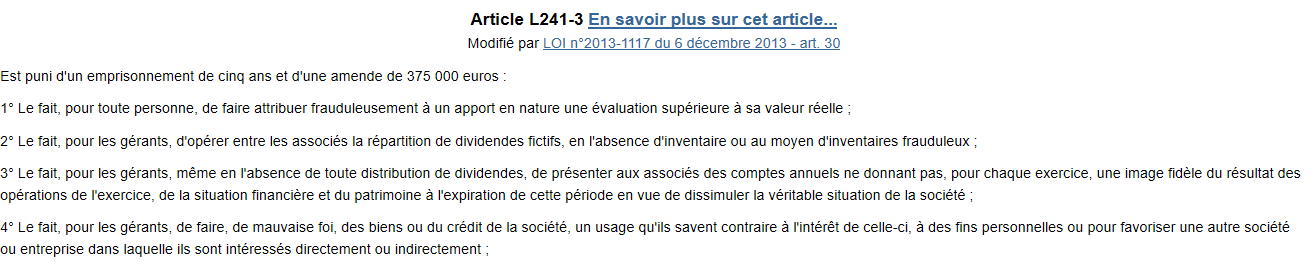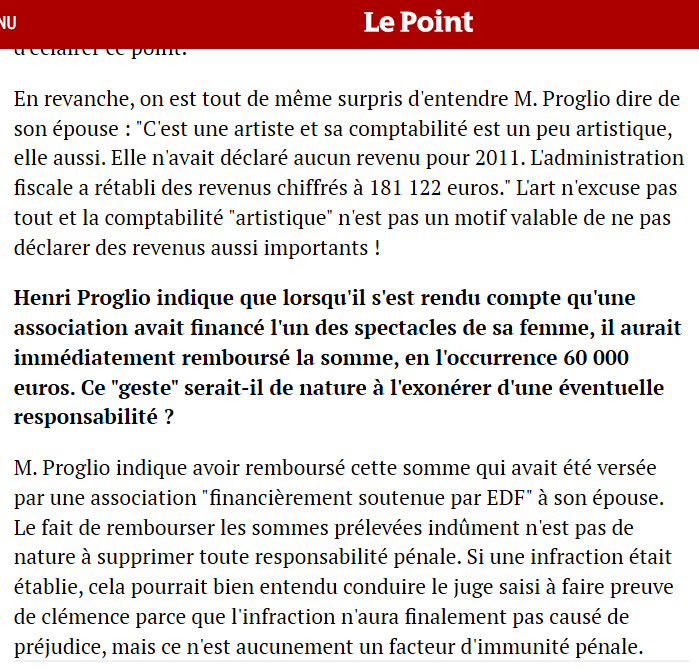On se souvient qu’un dispositif spécial a été mis en place au printemps dernier pour permettre aux sociétés et aux autres personnes morales et groupements non personnifiés de droit privé de tenir leurs assemblées pendant la crise sanitaire. C’est une ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui a mis en place de dispositif, que nous avions analysé ici pour le Club des Juristes.
Ce dispositif arrive à expiration dans les jours qui viennent, et même s’il est prorogé, il ne va pas l’être sans un « trou » de quelques jours, qui soulève de délicates questions de droit.
I – L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.
La possibilité de participer aux assemblées « à huis clos » s’est faite au détriment des droits des associés, actionnaires et autres participants à ces assemblées, puisque le cœur du dispositif a consisté à permettre la tenue des assemblées sans participation physique de ces personnes.
L’article 4 de l’ordonnance a en effet prévu que :
Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.
En substance, quand une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, cette assemblée peut se tenir « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle », la participation se faisant « selon les autres modalités prévues par les textes » régissant cette assemblée, et « Les décisions sont alors régulièrement prises ».
Ce texte d’exception avait été pris pour une durée expirant le 31 juillet 2020, prorogée ensuite au 30 novembre.
A défaut de prorogation supplémentaire ou de nouvelle ordonnance, une AG qui se tiendra à compter du 1er décembre ne pourra donc pas bénéficier de ce dispositif, et elle devra réunir physiquement les associés ou actionnaires, sauf possibilité de participer à distance ou de tenir l’assemblée autrement qui résulterait de la loi ou des statuts.
II – L’ordonnance de prorogation attendue.
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a habilité le Gouvernement à prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement (…) du I de l’article 11 (…) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ». Un certain nombre de champs, prévus par la loi du 23 mars 2020, sont exclus par la loi du 14 novembre 2020 dont celui consistant à prendre un texte « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions » et qui avait conduit à l’adoption de la très riche ordonnance n° 2020-306.
N’est pas exclu en revanche le f) du 2° du I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 qui avait permis de prendre au printemps dernier une ordonnance « simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ». On aura reconnu l’ordonnance n° 2020-321.
Est donc attendue une deuxième ordonnance permettant la tenue des assemblées sans la présence physique des associés / actionnaires, qui devrait prendre la forme d’une ordonnance modifiant le texte préexistant.
Des projets d’ordonnance et de décret ont circulé, mais le Conseil des ministres qui s’est réuni hier, le 25 novembre 2020, n’avait pas mis à son ordre du jour d’ordonnance traitant des assemblées.
Cela va-t-il poser un problème ?
III – Un problème de continuité ?
Le 30 novembre à minuit, l’ordonnance n° 2020-321 va donc devenir inactive.
Il est probable qu’il faudra attendre le Conseil des ministres du 2 décembre pour que soit présentée la nouvelle ordonnance, ce qui devrait conduire à une publication de ce texte au Journal officiel le 3 décembre, éventuellement le 4.
Sans envisager les éventuelles différences qui pourront exister entre le régime résultant de l’actuelle ordonnance n° 2020-321 et celui résultant du texte qui prendra sa suite, quelle sera la conséquence du « trou » de quelques jours pendant lequel les assemblées ne pourront pas se tenir à huis clos ? Les AG vont-elles être prises dans une faille spatio-temporelle?

Précisons d’emblée que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit dans son article 10 que les ordonnances qui vont être adoptées peuvent s’appliquer de manière rétroactive… ou quelque chose d’approchant!
C’est dans le sens d’une application rétroactive que l’on est tenté de lire le passage selon lequel « Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques ».
La référence finale aux « collectivités publiques » est cependant assez troublante, et pourrait écarter l’application rétroactive de l’ordonnance sur les AG à huis clos, a priori totalement étrangères aux collectivités publiques.
Le danger principal sera celui d’une AG qui se tiendrait à huis clos pendant la période de « vacance » (c’est-à-dire entre le 1er décembre et le 3 ou le 4 décembre). Il n’y aura de véritable risque que si la période de vacance n’est pas couverte par la nouvelle ordonnance. Si celle-ci ne précise pas qu’elle rétroagit, l’assemblée aura été tenue sans permettre aux associés / actionnaires d’y participer physiquement, avec des risques divers (annulation, responsabilité civile et pénale). Pour rappel, le droit français sanctionne toujours de deux ans d’emprisonnement et 9.000 euros d’amende le fait « d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires« .
Notons que dans le même temps, il n’est pas certain qu’une assemblée puisse se tenir en présentiel, puisque le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit, sauf exception, « Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (…) mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes« …
Ce même texte dispose par ailleurs que « Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes« , lesdits motifs ne concernant a priori pas la participation à une AG.
Une difficulté moins visible concerne les assemblées qui sont convoquées pour le mois de décembre 2020 ou janvier 2021, c’est-à-dire sans visibilité claire de ce que sera l’ordonnance applicable au jour où l’assemblée se tiendra. Il est probable qu’un texte permettra la tenue à huis clos de l’AG, mais les modalités précises de cette tenue ne seront connues que lorsque le texte sera publié au Journal officiel…
Bruno DONDERO